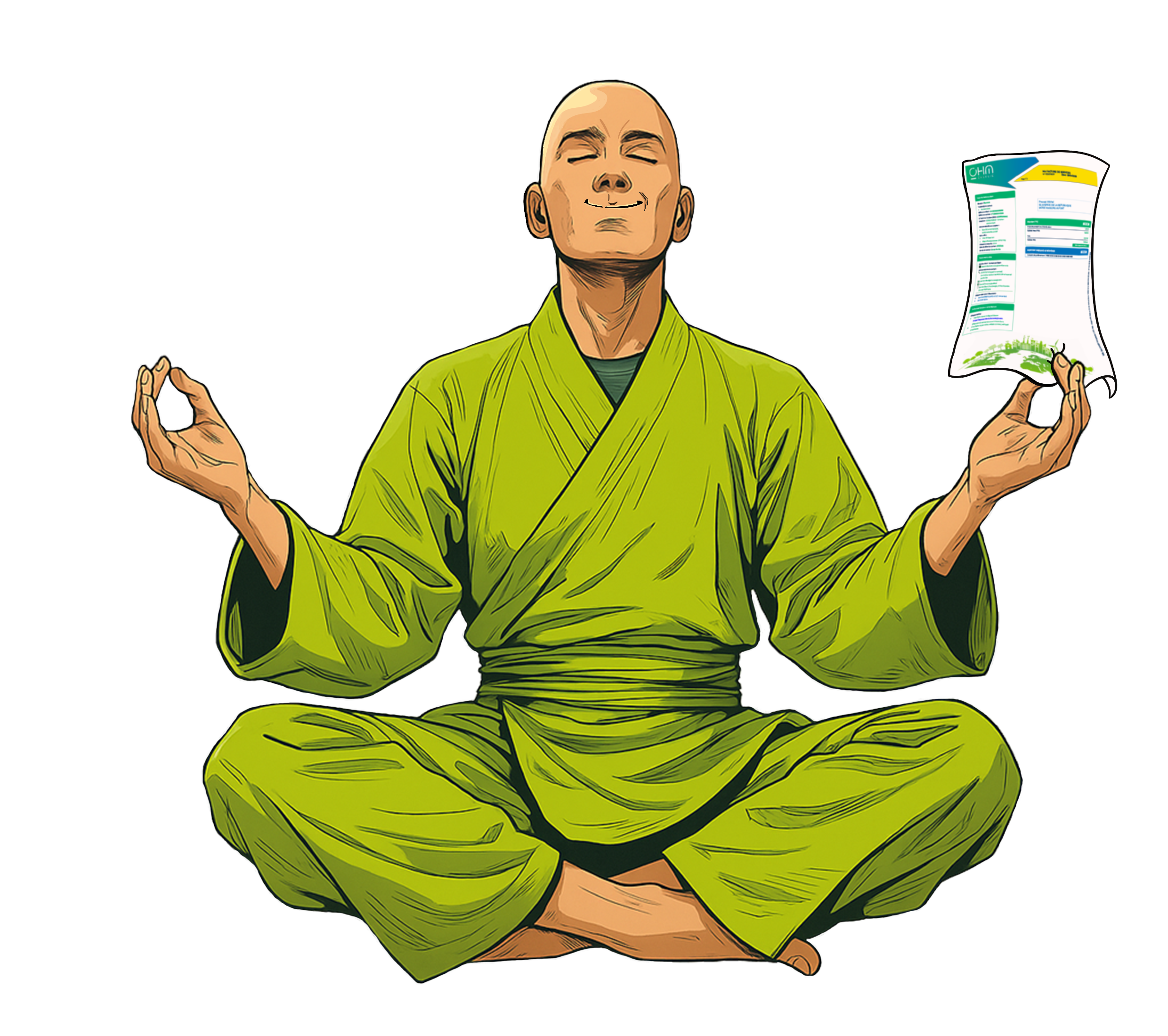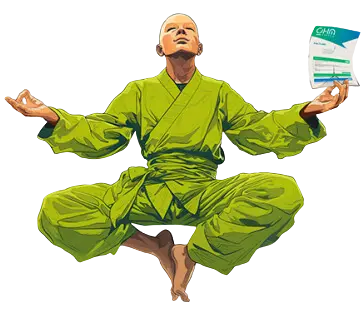Le parc nucléaire français : état actuel et perspectives
La France et le nucléaire, c’est une longue histoire. Actuellement composé de 56 réacteurs en activité et d’un EPR en construction, le parc nucléaire hexagonal continue de jouer un rôle majeur dans la production d’électricité. Mais à l’heure de la transition énergétique, quel est l’avenir du nucléaire en France ? Entre projets de réacteurs de nouvelle génération, gestion des déchets et objectifs de réduction de la dépendance, découvrez où en est le secteur nucléaire français et ce qui l’attend pour les années à venir.

Sommaire
Où en est le parc nucléaire français ?
L’histoire du nucléaire en France est un chapitre clé dans l’évolution de la politique énergétique du pays. Si elle remonte aux années 1940, c’est seulement après la Seconde Guerre mondiale que le nucléaire a pris une place centrale dans la stratégie énergétique hexagonale. Alors, pour bien comprendre où nous en sommes, commençons par un bref retour aux origines…
L'histoire du nucléaire en France
L’aventure du nucléaire « bleu, blanc, rouge » débute dans les années 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, sous l’impulsion de scientifiques comme Irène Joliot-Curie, fille de Marie Curie ou encore Frédéric Joliot-Curie.
Le saviez-vous ?
En 1939, les quatre chercheurs français Joliot-Curie, Von Halban, Perrin et Kowarski rédigent un article majeur et déposent pour la première fois plusieurs brevets, concernant la fission nucléaire.
Après la guerre, en octobre 1945, Charles de Gaulle, alors président, prend la décision de créer le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), afin de coordonner les différentes recherches sur le nucléaire – à la fois civil et militaire – et de préparer l’Hexagone à l’exploitation de cette énergie. On va passe les détails, mais à cette époque, autant dire que c’est l’émulation, l’approvisionnement en uranium est au cœur du débat et de nombreuses entreprises privées s’emparent à leur tour de la question, de sorte à accélérer les recherches autour de l’épineuse question nucléaire.
Les années 1960 marquent le début de l’ambition nucléaire de la France, avec pour objectif de devenir un leader dans le domaine. À la clé ? La construction d’une poignée de réacteurs nucléaires. Pourtant, ce n’est qu’en 1973 que la géopolitique s’invite dans le débat et boost un peu plus l’atome sur le territoire hexagonal. Eh oui, suite à la guerre du Kippour, une crise pétrolière majeure s’engage. Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’allient afin de faire monter en flèche les prix du pétrole, en représailles à l’occupation des territoires par Israël depuis 1967. Prise de conscience pour la France, qui prend conscience de sa dépendance critique vis-à-vis du pétrole étranger et de la nécessité de diversifier ses sources d’énergie¹.
En réponse à cette crise énergétique, le 6 mars 1974, Pierre Messmer, alors premier ministre du gouvernement de Georges Pompidou, annonce le fameux « Plan Messmer ». Il s’agit de redonner son indépendance énergétique à la France en passant – entre autres – par la construction de plus de nouvelles centrales nucléaires. En écho à cette initiative, un peu plus tard, vous vous souviendrez peut-être de la célèbre citation de Valéry Giscard D’Estaing :
« En France on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ! »
La machine est lancée, en 1981, le nombre de réacteurs en service passe à 56. La France couvre alors environ 70 % de ses besoins en électricité grâce au nucléaire, un des plus hauts taux mondiaux. Si depuis, l’atome a perdu de sa superbe, il reste tout de même la première source de production électrique hexagonal. Au 1er janvier 2025, le nucléaire représentait pas moins de 70 % de la production électrique française² :
Quel est le nombre de centrales nucléaires en activité aujourd'hui en France et où sont-elles ?
Le parc nucléaire français est constitué de 56 réacteurs à eau sous pression (REP), qui sont de la génération II, et d’un réacteur de génération III en construction à Flamanville (Manche), le fameux EPR, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Ce réacteur, plus moderne, promet de produire de l’électricité de manière plus sûre et efficace, une fois sa mise en service officialisée !
La particularité hexagonale consiste en la standardisation de son parc nucléaire : tous les 56 réacteurs REP mobilisent la même technologie, ce qui les rend techniquement assez similaires. Ces réacteurs sont répartis sur 18 sites de centrales nucléaires. Chaque centrale accueillant entre 2 à 6 réacteurs.
Les réacteurs sont classés par leur modèle (appelé « palier ») et par leur puissance électrique, exprimée en mégawatt électrique (MWe). Il y existe trois principales catégories de puissance :
- 900 MWe : ce sont les plus nombreux, avec 32 réacteurs répartis en deux paliers : CP0 (4 réacteurs, principalement à Bugey 1, Bugey 2 et CPY, 28 réacteurs dans des sites comme Tricastin, Gravelines, Dampierre, Blayais, Chinon, Cruas et Saint-Laurent).
- 1300 MWe : il existe 20 réacteurs de cette puissance en France, divisés en deux paliers : le palier P4 (avec 8 réacteurs, à Paluel, Saint-Alban et la centrale nucléaire de Flamanville) et le P’4 (avec 12 réacteurs, à Belleville-sur-Loire, la centrale nucléaire de Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly).
- 1450 MWe : ll n’y a que 4 réacteurs qui présentent cette puissance, tous du palier N4, répartis à Chooz et Civaux³.
Ce modèle standardisé permet une gestion optimisée, tout en offrant une production d’électricité décarbonée et fiable.
*Illustration issue du site de l’ASNR (Ex-IRSN)
Pour le récap’, vous pouvez apercevoir des réacteurs nucléaires à :
- Bugey (Ain) – 4 réacteurs (900 MWe) ;
- Tricastin (Drôme) – 4 réacteurs (900 MWe) ;
- Gravelines (Nord) – 6 réacteurs (900 MWe) ;
- Dampierre (Loiret) – 4 réacteurs (900 MWe) ;
- Blayais (Gironde) – 4 réacteurs (900 MWe) ;
- Chinon (Indre-et-Loire) – 4 réacteurs (900 MWe) ;
- Cruas (Ardèche) – 4 réacteurs (900 MWe) ;
- Saint-Laurent (Loir-et-Cher) – 2 réacteurs (900 MWe) ;
- Paluel (Seine-Maritime) – 4 réacteurs (1300 MWe) ;
- Saint-Alban (Isère) – 2 réacteurs (1300 MWe) ;
- Flamanville (Manche) – 2 réacteurs (1300 MWe), 1 EPR en construction ;
- Belleville-sur-Loire (Cher) – 2 réacteurs (1300 MWe) ;
- Cattenom (Moselle) – 4 réacteurs (1300 MWe) ;
- Golfech (Tarn-et-Garonne) – 2 réacteurs (1300 MWe) ;
- Nogent-sur-Seine (Aube) – 2 réacteurs (1300 MWe) ;
- Penly (Seine-Maritime) – 2 réacteurs (1300 MWe) ;
- Chooz (Ardennes) – 2 réacteurs (1450 MWe) ;
- Civaux (Vienne) – 2 réacteurs (1450 MWe).
Ces réacteurs font donc partie du vaste réseau de centrales nucléaires françaises réparties sur plusieurs régions. Ces dernières années, le parc nucléaire hexagonal a fait les frais de plusieurs déconvenues, entraînant une baisse du niveau de production nucléaire : entre les conséquences de la crise sanitaire sur la maintenance et un problème de corrosion, plusieurs réacteurs ont dû être fermés. Actuellement, tous sont de nouveau en service.
💡 Rappel : la centrale nucléaire de Fessenheim (Grand Est) a définitivement élé mise à l’arrêt depuis le 30 juin 2020.
Quelle est la puissance du parc français ?
En France, l’électricité nucléaire est la principale source de production et de consommation. Si vous avez suivi, vous savez désormais qu’elle est générée par 57 réacteurs de puissances variées, répartis sur l’ensemble du territoire. La puissance totale installée du parc nucléaire français atteint 61,4 GW⁵.
À savoir 💡 Malgré sa superficie, la France possède possède le deuxième parc nucléaire du monde, derrière les États-Unis (92 réacteurs) et devant la Chine (55 réacteurs)⁴. |
Si, en 2024, après quelques années en dents de scie, la France a retrouvé des niveaux impressionnants de production d’électricité et a même battu quelques records, du côté de l’atome, l’heure n’est pas à la fête. La production annuelle d’électricité d’origine fossile a atteint son plus bas niveau depuis les années 1950, avec seulement 19,9 TWh. Fait marquant, pour la première fois, elle est inférieure à la production solaire, qui a atteint 23,3 TWh. Les centrales à gaz ont été peu sollicitées, produisant 17,4 TWh en 2024, contre 29,2 TWh en 2023. Quant aux centrales à charbon (0,7 TWh) et au fioul (1,8 TWh), elles ont maintenu des niveaux de production très faibles. Notons cependant que la production bas-carbone (nucléaire et renouvelable) a pour la première fois atteint le seuil de 95 % de l’électricité produite en France⁶.
C’est composé comment, un réacteur nucléaire ? Un réacteur nucléaire est composé de deux circuits. Le circuit primaire transporte l’eau chauffée par la fission du combustible dans le cœur du réacteur. Cette chaleur est transférée au circuit secondaire, qui produit de la vapeur pour faire tourner une turbine et générer de l’électricité. Les deux circuits sont séparés pour éviter la contamination radioactive. Enfin, Le circuit de refroidissement évacue la chaleur excédentaire du réacteur. Il utilise généralement de l’eau prélevée dans un fleuve ou une mer, qui circule dans un échangeur thermique pour dissiper la chaleur avant de retourner dans l’environnement. |
Qui exploite le parc nucléaire français ?
Sans surprise, le parc nucléaire français est principalement exploité par le géant historique de l’électricité en France, EDF. L’entreprise gère la grande majorité des réacteurs nucléaires du pays – soit, rappelons-le, 56 réacteurs répartis sur 18 sites. En plus de produire de l’électricité, EDF est responsable de la maintenance, de la sécurité et de la gestion de ce parc nucléaire. Toutefois, EDF n’est pas seule à intervenir dans le secteur nucléaire. Framatome, une de ses filiales, est un acteur clé dans la construction, la maintenance et la fourniture de composants pour les réacteurs nucléaires. De plus, d’autres entreprises comme Orano (anciennement Areva) participent à la gestion du combustible nucléaire et au recyclage des déchets.
Notez également qu’en France, plusieurs administrations sont impliquées dans la gestion de l’énergie nucléaire :
- Le Ministère de l’Énergie, via la DGEC (Direction Générale de l’Énergie et du Climat), la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) et le SHFDS (Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité).
- Le Ministère des Affaires Étrangères, le Secrétariat Général aux Affaires Européennes et le Ministère de la Défense.
- Le Ministère de l’Économie et de l’Industrie, qui supervise diverses entités comme l’APE (Agence des Participations de l’État) et la DGE (Direction Générale des Entreprises). La DGEC coordonne notamment l’ensemble des actions concernant l’énergie nucléaire civil, supervise des acteurs clés comme EDF, Framatome, Orano, et l’ANDRA, et veille à l’adaptation des textes législatifs.
Le gouvernement français conserve une large responsabilité dans la gestion de la sûreté nucléaire, en collaboration avec l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), qui reste un acteur clé pour la transparence et la sécurité dans ce secteur. Pour info, l’ASN, créée par la loi du 13 juin 2006, est un organisme indépendant chargé de contrôler la sûreté nucléaire et la radioprotection en France. Mais voyons plutôt…
Quels sont les enjeux de sécurité et de maintenance des centrales ?
Lorsqu’on parle d’énergie atomique, forcément, on s’imagine bien que les enjeux de sécurité et de maintenance des centrales sont essentiels pour assurer une production d’électricité à la fois fiable et sûre, tout en minimisant les risques pour les travailleurs, le public et l’environnement. Alors, il va de soi que dans ce cadre, la sûreté nucléaire représente la priorité absolue. C’est pourquoi, EDF, responsable de l’exploitation des centrales, doit garantir que toutes les installations respectent des normes de sécurité strictes. Cela inclut la prévention et la gestion des risques techniques (comme des dysfonctionnements ou des pannes), mais aussi des risques humains (erreurs de manipulation, gestion des ressources humaines). Pour cela, des systèmes de sécurité redondants sont mis en place, ce qui signifie qu’en cas de défaillance d’un système, un autre prendra le relais pour assurer la continuité de la sûreté. En outre, des mesures de radioprotection sont rigoureusement appliquées pour protéger les travailleurs et l’environnement.
La maintenance des réacteurs nucléaires est une tâche de longue haleine qui doit être réalisée régulièrement pour assurer le bon fonctionnement des centrales. Cela inclut des vérifications périodiques des équipements (pompes, générateurs, circuits électriques, etc.) et des révisions des réacteurs tous les 10 ans environ, lors des arrêts programmés. Lors de ces périodes d’arrêt, les réacteurs sont vidés de leur combustible puis sont soumis à un contrôle approfondi, pour identifier d’éventuelles défaillances. Des inspections continues sont également menées tout au long de l’année (et surtout, tout au long de la vie des centrales) pour surveiller les performances des réacteurs et prévenir toute situation à risque.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, organisme indépendant, veille quant à elle à la conformité de ces pratiques. En plus de réaliser des inspections régulières, l’ASN contrôle les événements significatifs, qu’ils soient mineurs ou majeurs, et s’assure que des actions correctives sont prises par EDF. Ces événements sont par ailleurs rendus publics pour garantir une transparence totale vis-à-vis du public. En cas de non-conformité, l’ASN a le pouvoir de sanctionner EDF, voire de suspendre l’exploitation d’un réacteur, afin de garantir la sécurité à tout moment⁸.
Quels sont les projets nucléaires en cours et les perspectives ?
Malgré une flopée de levées de boucliers, l’Hexagone ne cache pas ses ambitions en matière de nucléaire et cherche par tous les moyens à relancer son idylle essoufflée avec l’atome. Les projets nucléaires en France sont aujourd’hui au cœur des ambitions énergétiques du pays, particulièrement dans le cadre du plan France 2030, avec un programme de constructions XXL.
L’un des projets les plus incontournables n’est autre que l’immanquable développement du réacteur EPR à Flamanville, un modèle de réacteur de génération III qui promet de produire de l’électricité de manière plus sûre et plus efficace qui devrait – un jour – se greffer aux centrales existantes. Cependant, ce projet a rencontré pléthores difficultés techniques, des retards et des dépassements de coûts importants (c’est le moins que l’on puisse dire). Malgré ces obstacles de taille, le gouvernement reste déterminé à finaliser ce projet, car il représente un symbole fort du futur nucléaire français.
Parallèlement à ce grand chantier, la France se tourne vers des réacteurs de petite taille, appelés SMR (Small Modular Reactors). Ces réacteurs, plus compacts et flexibles, sont conçus pour être déployés rapidement et dans des zones où des réacteurs de plus grande taille seraient difficiles à installer.
Un autre domaine majeur de développement concerne la gestion des déchets nucléaires. Le projet Cigéo à Bure vise à créer un site de stockage profond pour les déchets les plus radioactifs, dans l’objectif de les isoler pour des milliers d’années. Ce projet fait partie d’une approche plus large, qui vise en somme à améliorer la durabilité de l’industrie nucléaire et à répondre aux préoccupations liées à la gestion des déchets à long terme.
Les perspectives à moyen et long terme sont également marquées par une volonté de rendre le nucléaire plus « vert ». Le gouvernement a ainsi annoncé son intention de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50 % d’ici à 2035, tout en soutenant le développement de technologies plus sûres et plus propres. Objectif : la complémentarité du nucléaire avec les énergies renouvelables⁹.
Le nucléaire est-il une énergie renouvelable ?
Il est possible que depuis longtemps, cette question vous brûle les lèvres : l’électricité nucléaire est-elle oui ou non une énergie renouvelable ? La réponse est non ! Le nucléaire n’est pas considéré comme une énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont celles qui se régénèrent naturellement et rapidement, comme l’énergie solaire, l’éolien, l’hydraulique ou encore la géothermie, par exemple. Ces sources d’énergie sont inépuisables à l’échelle humaine, car elles sont constamment régénérées par des phénomènes naturels.
En revanche, l’énergie nucléaire provient de la fission de l’uranium, un combustible fossile non renouvelable. Bien que le nucléaire soit une source d’énergie dite « décarbonée » (il ne produit pas directement de CO₂ pendant la production d’électricité), il n’est pas renouvelable pour autant. Eh oui, l’uranium est une ressource finie qui peut s’épuiser. De plus, la gestion des déchets radioactifs produits par les réacteurs nucléaires pose des défis importants sur le long terme. Cependant, si vous recherchez une énergie 100 % verte, issue de sources VRAIMENT renouvelables, vous pouvez toujours opter pour un nouveau fournisseur d’énergie, comme… Ohm Énergie…
Quid du nucléaire dans le monde
Avant de se quitter, si nous faisions un petit tour du monde du nucléaire ? Le parc nucléaire mondial est composé de pas moins de 417 réacteurs, répartis dans « seulement » 31 pays. En 2024, la production d’électricité nucléaire à l’échelle planétaire a atteint pas moins de 2 699 TWh, soit environ 9 % de la production mondiale d’électricité. Les États-Unis et la France sont les leaders, représentant à eux seuls près de 50 % de la capacité nucléaire mondiale. Pour rappel, les États-Unis comptent 93 réacteurs, tandis que la France en possède 56. La Chine, quant à elle, connaît une forte croissance de son parc nucléaire avec 51 réacteurs en fonctionnement et de nombreux projets en cours pour augmenter encore un peu plus cette capacité¹⁰.
Le nucléaire joue un rôle clé dans la production d’énergie bas-carbone, particulièrement dans les pays où la demande en électricité est élevée et où la transition vers des sources d’énergie renouvelables n’est pas encore totalement achevée. Cependant, certains pays, comme l’Allemagne, ont pris la décision de sortir progressivement du nucléaire à la suite d’accidents graves, comme celui de Fukushima, en 2011.
Les réacteurs actuels sont principalement de génération II et III, mais plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, misent sur de nouvelles installations, avec des réacteurs de génération IV, comme les EPR (réacteurs pressurisés européens) et les SMR (réacteurs modulaires de petite taille), pour assurer une production d’électricité plus sûre, plus efficace et moins coûteuse à long terme. Affaire à suivre…
Sources
- Siren Énergies – Histoire du nucléaire en France
- RTE – La production d’électricité par filière (éco2mix)
- IRSN – La sûreté du parc de réacteurs nucléaires français
- Picbleu – Carte des 19 centrales nucléaires en France, usines et stockage
- EDF – Le nucléaire en chiffres
- RTE – La production d’électricité française atteint son plus haut niveau depuis 5 ans
- Ministère de la Transition Écologique – Acteurs et gouvernance du nucléaire
- ASN – La sûreté des centrales nucléaires : radioprotection et environnement
- Ministère de l’Économie – France 2030 : un plan ambitieux pour le nucléaire de demain
- Connaissance des Énergies – Parc nucléaire mondial et production d’électricité
Les derniers articles sur l'énergie verte
Découvrez combien d’énergie votre frigo consomme, comment réduire sa consommation quotidienne et comment choisir un frigo économe.