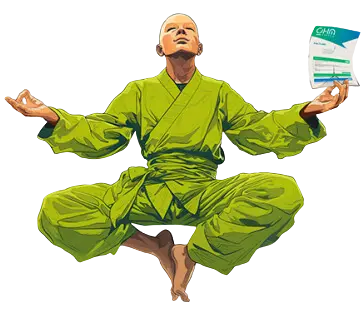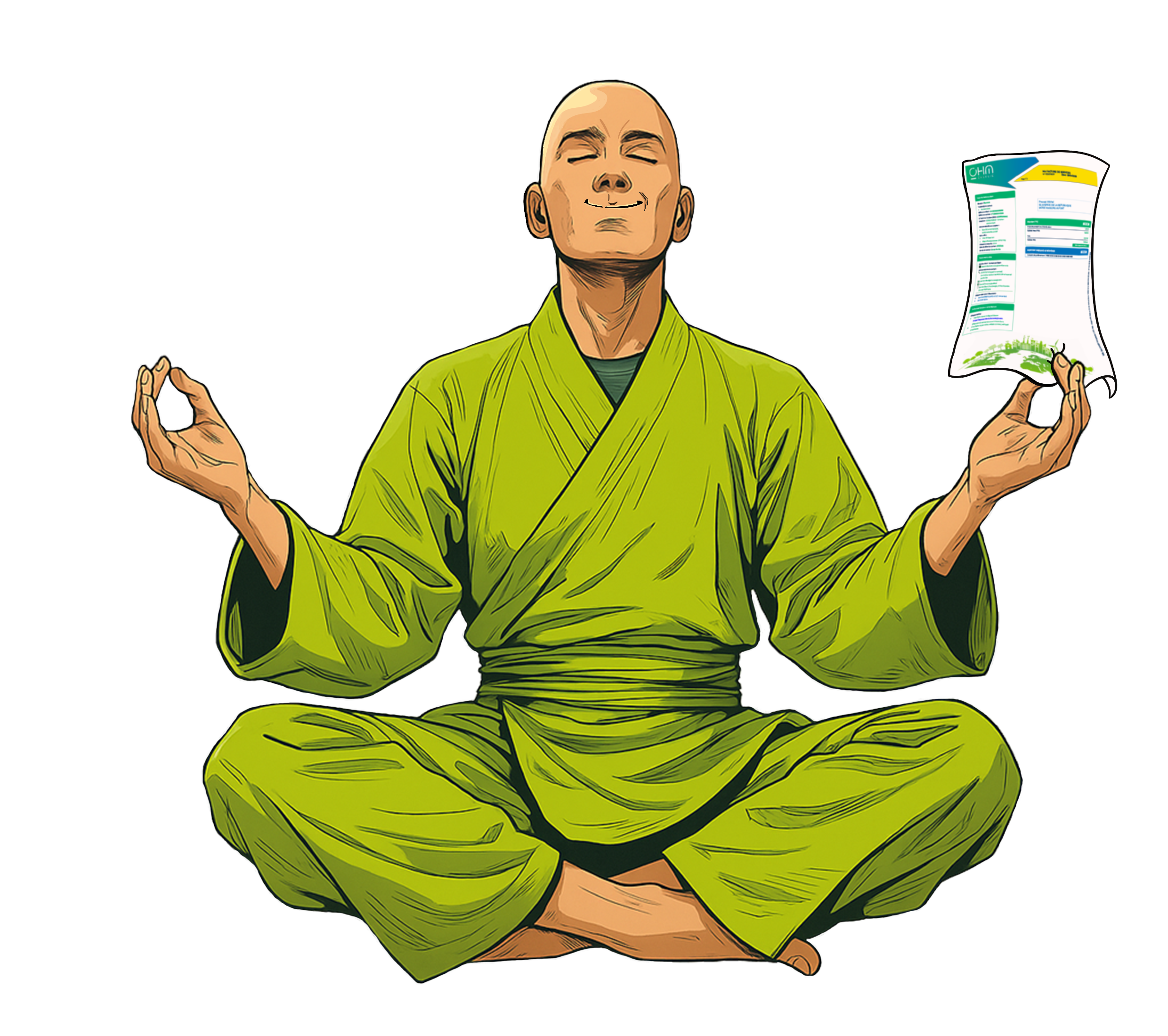Les vraies conséquences de la fast fashion sur notre monde
À l’heure où l’urgence climatique et la consommation durable deviennent des priorités, la fast fashion, ce modèle industriel qui fabrique vite, vend moins cher et renouvelle sans cesse les collections, mérite qu’on s’attarde sur ses conséquences. Cet article décrypte les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la fast fashion, et propose des pistes concrètes pour consommer autrement, même pendant les promotions.

Sommaire
À retenir
- La fast fashion produit rapidement et à bas coût, favorisant la surproduction et l’externalisation vers des pays à faibles coûts salariaux.
- En France, environ 7 millions de vêtements neufs sont achetés chaque jour, et l’industrie textile représente 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon l’ADEME.
- La fabrication textile consomme beaucoup d’eau et d’énergie, relâche pesticides, microplastiques et produits chimiques, et génère des déchets difficiles à recycler, avec seulement 260 000 tonnes collectées sur 800 000 mises sur le marché.
- Les conditions de travail sont précaires dans les pays de production, la désindustrialisation française a supprimé plus de 300 000 emplois depuis 1990, et des actions comme acheter d’occasion, réparer ou choisir des fibres responsables permettent de réduire l’impact global.
Qu’est-ce que la fast fashion ?
La fast fashion désigne un modèle économique fondé sur la production rapide et bon marché de vêtements pour coller en temps réel aux tendances. Les géants du secteur proposent parfois jusqu’à 7 200 nouveaux modèles par jour¹, avec des t-shirts vendus quelques euros à peine.
Ce modèle repose sur trois piliers :
- la surproduction à bas coût,
- le renouvellement accéléré des collections,
- et l’externalisation de la production vers des pays à faibles coûts salariaux.
S’il semble avantageux pour le consommateur, il cache un coût réel pour la planète et pour celles et ceux qui fabriquent nos vêtements.
Impacts environnementaux : ressources, pollution, déchets
Une empreinte carbone significative
En France, on achète environ 7 millions de vêtements neufs par jour¹. Chaque Français a acquis 40 pièces d’habillement et 4 paires de chaussures en 2022.²
À l’échelle européenne, la consommation textile représente la 4ᵉ source d’impact sur l’environnement et le climat, après l’alimentation, le logement et les transports.¹
Dans le monde, selon l’ADEME, le textile est responsable d’environ 8 % des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que l’aviation et le trafic maritime réunis.¹
Pourquoi ? Parce qu’environ la moitié des vêtements vendus en France sont fabriqués en Asie, principalement en Chine, qui concentrait plus de 40 % du marché mondial du textile et de l’habillement en 2021.² Or, le transport joue un rôle non négligeable : un t-shirt envoyé en avion depuis le Bangladesh émet 14 fois plus de CO₂ qu’un transport par bateau, sans compter les émissions liées à la production elle-même.²
Consommation d’eau : une ressource sous pression
La fabrication textile consomme de l’eau à toutes les étapes² :
- Culture des fibres naturelles (coton notamment),
- Teinture et impression, très gourmandes en rinçage,
- Transports et emballages,
- Et même l’entretien (lavages, séchage, repassage).
Le saviez-vous ?
- Produire 1 kg de coton nécessite 58 m³ d’eau, contre 0,38 m³ pour le polyester²
- La fabrication d’un jean porté 50 fois consomme environ 7 000 litres d’eau.¹
Dans certaines régions, comme l’Asie centrale, la culture intensive du coton a même contribué à l’assèchement de la mer d’Aral, l’un des désastres écologiques majeurs du XXᵉ siècle.
Mais l’impact ne s’arrête pas là : la production textile est également énergivore, notamment pour le filage, le tissage, la teinture et l’ennoblissement, qui mobilisent électricité et combustibles fossiles, contribuant ainsi aux émissions de CO₂ et à la consommation globale d’énergie.
Pour les particuliers sensibles à ces enjeux, Ohm Énergie propose son offre Extra Éco, qui permet de réduire sa facture d’électricité grâce à un prix du kWh avantageux.
Pollution chimique : eau, air et microplastiques
La fast fashion génère des impacts environnementaux importants à chaque étape de sa production, affectant les ressources naturelles, la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que la biodiversité.
Pollution de l’eau
Les matières naturelles comme le coton nécessitent pesticides et engrais, souvent lessivés vers les rivières et nappes phréatiques. Les matières synthétiques, elles, reposent sur le pétrole et rejettent des microplastiques à chaque lavage. Une seule pièce peut relâcher des centaines de milliers de fibres.² Ces microplastiques se retrouvent dans les rivières, les océans, la chaîne alimentaire .
Pollution de l’air
Les étapes de filature, teinture et confection rejettent des composés organiques volatils et des poussières fines. En aval, les transports internationaux et la logistique e-commerce (emballages, retours) aggravent encore le bilan carbone.
Le saviez-vous ?
La loi française AGEC (2020) a instauré un affichage environnemental pour les vêtements, développé par l’ADEME et le ministère de la Transition écologique, afin de rendre visible leur coût écologique. ³
Déchets, fin de vie et recyclage : une montagne de textile
La fast fashion repose sur le cycle « acheter, jeter, racheter ». Résultat : des montagnes de déchets textiles, mal triés ou non recyclés.
Selon l’ADEME, sur les 800 000 tonnes de textiles mises sur le marché français chaque année, seules 260 000 tonnes sont collectées². Et parmi elles :
- 58,6 % sont réutilisées (souvent exportées)² : Des enquêtes récentes montrent que d’immenses quantités de vêtements d’occasion européens sont exportées en Afrique de l’Est, où ils finissent parfois dans des décharges à ciel ouvert
- 32,5 % recyclées² : elles servent généralement à fabriquer des chiffons (par exemple pour l‘industrie automobile) ou des isolants (pour la maison). Une toute petite partie peut être recyclée pour refaire des vêtements, du linge ou des chaussures mais elle ne représenterait pas plus de 0,1 % des mises sur le marché. Actuellement, les textiles recyclés utilisés dans les vêtements neufs proviennent surtout d’autres sources (comme des bouteilles en plastique). Il est en effet encore très difficile techniquement de développer le recyclage des textiles .
- 8,8 % valorisées en énergie²,
- 0,1 % éliminées² : Les vêtements de mauvaise qualité, abimés ou composés de fibres mélangées sont difficiles à recycler. Beaucoup finissent brûlés ou enfouis, libérant encore du CO₂.
Impacts sociaux : conditions de travail et inégalités
Des conditions de fabrication précaires
Pour produire à bas coût, la fast fashion externalise la production dans des pays où la main-d’œuvre est bon marché. Les travailleurs, majoritairement des femmes, subissent salaires faibles, heures excessives et sécurité insuffisante. Des ONG comme Oxfam France documentent régulièrement ces conditions, notamment après des drames comme l’effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh, qui avait causé plus de 1 100 morts.²
Emplois, filière, désindustrialisation
Toujours selon l’ADEME : « L’industrie textile française a perdu plus de 300 000 emplois depuis 1990 … »⁴. Cette désindustrialisation, accentuée par la mondialisation et la recherche du coût minimal, affaiblit les filières locales et les savoir-faire historiques (textiles, tanneries, filatures).
Coût culturel et économique : uniformisation et fragilité des filières locales
La domination des grandes chaînes mondiales de fast fashion entraîne une homogénéisation des styles et peut écraser les savoir-faire locaux : artisans, petites maisons et créateurs indépendants ont du mal à rivaliser avec des prix bas rendus possibles par des économies d’échelle et des externalisations. De plus, considérer les vêtements comme jetables décourage les consommateurs de les réparer ou de les acheter d’occasion, ce qui fragilise la filière du développement durable.
Le rôle des promotions massives dans l’accélération du problème
Les événements commerciaux comme le Black Friday amplifient le phénomène fast fashion :
- achats impulsifs,
- renouvellement rapide,
- accumulation d’articles peu portés.
Bref on alimente la roue du « take-make-waste » (prélever, fabriquer, consommer, jeter).
Les ONG comme Zero Waste France alertent sur l’effet rebond de ces promotions, qui poussent à consommer davantage sous prétexte d’économiser.
D’ailleurs, le Black Friday n’est pas vraiment avantageux : les économies réalisées dépassent rarement 2 %.⁵ De plus, la durée de vie moyenne d’un vêtement bon marché, comme un article Shein, est d’environ 65 jours.⁶ Résultat : là où l’on pense faire des économies, il faut en réalité racheter beaucoup plus vite.
Résultat : une hausse de la production mondiale de textile et donc de l’impact carbone de l’industrie textile.
Que faire ? 8 actions concrètes pour consommer mieux (et réduire l’impact avant, pendant, après Black Friday)
Vous êtes victime d’écoanxiété ? Voici quelques conseils pour mieux vivre votre expérience shopping :
- Se demander si on en a vraiment besoin : prioriser la qualité sur la quantité. Acheter moins de pièces, mieux choisies. Pour cela, découvrez la méthode BISOU⁷, un moyen mnémotechnique pour se souvenir des 5 questions à se poser avant de sortir la carte bleue :
– Besoin : est-ce que j’en ai vraiment besoin ?
– Immédiat : cela peut-il attendre quelques jours ?
– Semblable : ais-je déjà un objet similaire ?
– Origine : d’où provient le vêtement et comment a-t-il été fabriqué ?
– Utile : va-t-il vraiment me servir ?
- Privilégier l’occasion : la revente et la seconde main prolongent la durée de vie des vêtements et évitent des productions neuves inutiles. Les études montrent que prolonger la durée de vie moyenne d’un vêtement réduit fortement son empreinte globale.
⚠️ Mais attention au “piège Vinted” : la revente ne compense pas si on continue d’acheter du neuf à outrance.
- Réparer et recycler localement : favoriser la réparation et les filières locales de reprise pour éviter l’exportation et l’incinération. Le bonus réparation textile permet de réduire le coût des réparations.¹ Et pour trouver un réparateur près de chez vous, direction le site Refashion !⁸
- Choisir des fibres responsables : favoriser fibres recyclées ou issues de pratiques agricoles durables en vérifiant les labels. Prenez le temps de chercher des labels environnementaux sur les vêtements et les chaussures. Ils ne concernent pas encore beaucoup de produits mais cela vaut la peine de se renseigner. Labels recommandés par l’ADEME : GOTS, Oeko-Tex, Fair Wear Foundation.²
- Limiter la fréquence de lavage et utiliser des housses de filtration : laver moins souvent, à basse température, et considérer des dispositifs qui retiennent les microfibres. Cela réduit la pollution plastique et la consommation d’énergie.
- S’informer avant d’acheter : privilégier marques de mode éthique, transparentes sur leur chaîne d’approvisionnement et leurs pratiques, et se méfier du greenwashing. Le site Marques de France recense les acteurs valorisant une fabrication française et responsable : par exemple, 1083 se distingue par la transparence sur l’impact carbone de ses jeans, et Le T-Shirt Propre propose des vêtements issus d’élevages français.⁹
- Donner plutôt que jeter : les filières de don et les associations prolongent la vie utile des vêtements.
- Éviter les achats impulsifs pendant les promos : préparer une liste, reporter l’achat de 48 h pour évaluer la nécessité réelle.
- limiter les retours : quasiment toutes les enseignes de commerce en ligne proposent des retours facilités et/ou gratuits si le produit commandé ne convient pas. À l’échelle européenne, ces pratiques génèrent environ 5,6 millions de tonnes de CO2 (un chiffre presque équivalent aux émissions de carbone de la Suède en 2021)¹
Le saviez-vous ?
On estime que, dans le monde, les textiles synthétiques (principalement en polyester, en polyéthylène, en acrylique et avec de l‘élasthanne) sont responsables du rejet de 0,2 à 0,5 million de tonnes de microplastiques primaires dans les océans chaque année²
Conclusion : le vrai prix d’une "bonne affaire"
Le prix d’achat en magasin ne reflète pas le coût complet d’un vêtement. En amont, la fabrication consomme eau, énergie, produits chimiques ; en aval, la fin de vie génère déchets et pollution ; entre les deux, des hommes et des femmes travaillent parfois dans des conditions précaires. S’opposer à l’achat impulsif du Black Friday, c’est influer sur la demande et, à terme, sur les pratiques industrielles. Chaque geste compte : acheter moins, mieux, réparer, prolonger. Voilà des actes simples qui font basculer le modèle vers une mode plus sobre et plus juste.
Pour aller plus loin dans une démarche responsable au quotidien et économiser de l’énergie, Ohm Énergie, fournisseur d’énergie renouvelable, propose une offre d’électricité 100 % verte, qui permet aux particuliers de réduire leur empreinte écologique tout en consommant de manière consciente. Adopter une énergie renouvelable est un pas concret pour allier économies et respect de la planète.
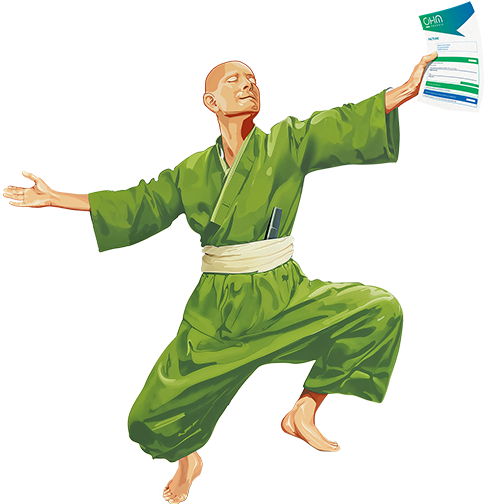
Sources
- ¹ Ademe : Soldes d’hiver : la planète bleue paie le prix fort
- ² Ademe : Tout comprendre : les impacts de la mode et de la fast-fashion
- ³ Ecologie.gouv : Affichage environnemental sur les vêtements
- ⁴ Ademe : « La question du changement de modèle s’impose aujourd’hui au secteur textile. »
- ⁵ Greenfriday
- ⁶ Radio France
- ⁷ Les écolos humanistes : la méthode bisou
- ⁸ Refashion : Trouver un réparateur près de chez moi
- ⁹ Marques de France
Les derniers articles sur l'énergie verte
RE2020 : tout savoir sur les nouveaux seuils carbone 2025 et 2028. Comprenez l’impact sur votre permis de construire et